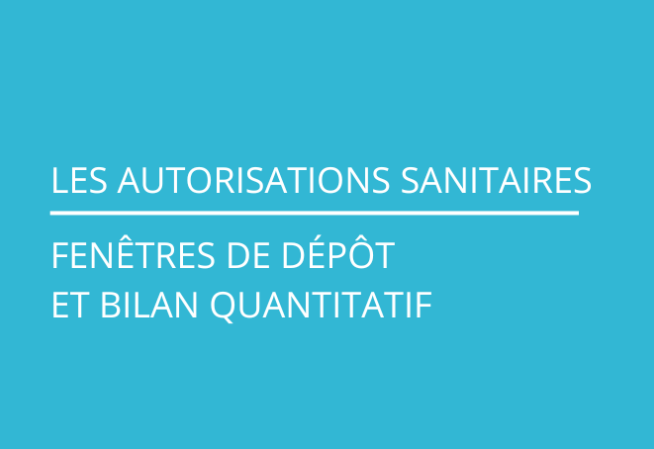Face à un risque d’importation du virus Oropouche en France, notamment en provenance du Brésil ou de Cuba pendant la période carnavalesque allant de fin février à mars, des recommandations sanitaires relatif à la circulation du virus Oropouche en Amérique latine et dans les Caraïbes, ont été faites pour les voyageurs et à la prise en soins des personnes infectées par le HCSP en novembre 2024
En effet, une circulation croissante de l’arbovirus Oropouche (OROV) présent habituellement en Amérique latine a été observée, principalement au cours du premier semestre 2024. Le vecteur principal à l’origine de la transmission du virus est un « moucheron » Culicoides paraensis qui a une activité diurne à crépusculaire. L’implication de vecteurs secondaires (autres espèces de culicidés et des moustiques) est discutée mais non démontrée. Le virus OROV circule entre un cycle selvatique avec différents réservoirs sauvages et un cycle urbain où l’homme est l’hôte principal. Le tableau clinique le plus fréquent, après une phase d’incubation courte, est biphasique avec une phase aiguë et une phase tardive.
Des formes neuroméningées ont été décrites. C’est un virus à ARN qui se réassortit fréquemment et dont un réassortant récent (OROVBR-2015-2024) pourrait expliquer l’extension de la zone de circulation et l’émergence actuelle dans de nouvelles zones d’Amérique du Sud et dans les Caraïbes dont Cuba. Se pose également la question d’un risque épidémique et d’un risque d’émergence aux Antilles françaises et en Guyane.
Des cas importés ont été signalés aux États-Unis, au Canada et en Europe. Pour la première fois, deux décès ont été notifiés chez des jeunes femmes brésiliennes sans comorbidité connue.
De plus, des formes materno‐foetales ont été décrites, et leur lien avec des morts foetales in utero et des malformations foetales suspecté. Le virus a également été isolé dans le sperme d’un homme infecté, ce qui pose la question d’une possible transmission sexuelle.
Le diagnostic clinique est complexe compte-tenu des symptômes aspécifiques et communs à la plupart des arboviroses dont la dengue et le virus Zika. Un diagnostic virologique est nécessaire, par reverse transcription-PCR jusqu’au 7ème jour suivant le début des symptômes et/ou par sérologie à partir du 5ème jour.
La protection personnelle antivectorielle repose sur les mesures habituelles, à savoir le port de vêtements couvrants, les répulsifs cutanés habituels et l’utilisation d’une moustiquaire imprégnée. Il n’existe actuellement aucun vaccin ni traitement curatif.
Les patients suspects d’infection OROV doivent faire l’objet d’un prélèvement biologique ainsi que d’un signalement sans délai à l’Agence Régionale de Santé. Les prélèvements sont à adresser au CNR des arbovirus – Marseille selon les recommandations résumées de la manière suivante
Recommandations HCSP pour le diagnostic virologique OROV :
En population générale :
- <J5 des symptômes : RT-PCR sur sang (un tube EDTA de 8,5 mL, non centrifugé ET un tube sec avec gel de 8,5 mL, centrifugé);
- J5 ≤ symptômes ≤ J7 : RT-PCR sur sang et sérologie Ig M ;
- >J7 des symptômes : sérologie seule ;
- Si forme neuro-invasive : RT-PCR sur LCS. La RT-PCR sang et aussi sur les urines ont été retrouvées positives jusqu’à J19 après le début des symptômes chez certains patients.
Chez la femme enceinte :
- Symptomatique et ayant voyagé dans une zone d’épidémie d’OROV : faire tests virologiques d’OROV et échographie fœtale ;
- Asymptomatique et ayant voyagé dans une zone d’épidémie d’OROV : faire échographie fœtale et discuter la réalisation des tests virologiques d’OROV ;
- Si infection à OROV confirmée et/ou d’anomalies fœtales échographiques : suivi par un centre de diagnostic prénatal nécessaire.